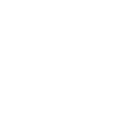Gigantesque, véritable eldorado, combien de superlatifs pourrait-on employer pour décrire le vignoble languedocien ? Longtemps considéré comme pourvoyeur de vins simples, réservés aux classes populaires, le Languedoc a réussi sa mue. Un virage qualitatif, intégré aujourd’hui par la plupart des français. Depuis, les meilleurs vignerons sont arrivés à une maturité stylistique qui leur permet de s’affranchir de l’influence de Bordeaux ou du Rhône. A travers le portrait de six vins, j’aimerais vous présenter le nouveau visage du Languedoc.
Là-bas, la vigne est partout ! L’aridité est telle qu’hormis des oliviers, point de salut pour d’autres cultures. En volume donc, le Languedoc se classe en tête des vignobles français, toutefois après Bordeaux si l’on ne considère que la catégorie AOC/AOP. L’IGP Pays d’Oc (Indication Géographique Protégée), qui n’est qu’une des seize IGP languedociennes, pèse à elle seule l’équivalent des trois quarts de la production bordelaise globale. Le Languedoc est ainsi la deuxième région productrice au monde après la Catalogne.
La reconnaissance du vignoble languedocien à délivrer des vins de grande qualité est récente. Le Languedoc, c’est un peu notre « nouveau Monde viticole ». Il s’y crée un domaine chaque semaine ou presque. Aucun autre vignoble n’attire autant d’investisseurs français ou étrangers. On y produit tous les styles de vins et pour toutes les « bourses ». Le Languedoc est une véritable « Mecque » pour les amateurs en quête de bons rapports qualité/prix/plaisir/découverte.
La nouvelle jeunesse du vignoble languedocien lui autorise d’ailleurs toutes les originalités. Les étiquettes peuvent se permettre d’être plus créatives. Jetez donc un coup d’œil à l’étiquette de la cuvée « Super Vieille Mule » de l’éclectique Jeff Carell. Ici le poids de l’appellation compte moins qu’ailleurs, l’appellation se décale souvent au dos de la bouteille, sur la contre-étiquette.
Les étiquettes alignent aussi souvent des noms de cépages. On en produit beaucoup en Languedoc, représentant tous les cépages les plus connus de France. Plus de huit bouteilles produites ici sont en catégorie IGP ou en simple Vin de France avec noms de cépages la plupart du temps.
Des noms de domaines s’imposent aussi, comme celui du Mas Jullien.
Lassés d’une production centrée sur des vins riches en alcool et sans grand intérêt gustatif, encore pléthore dans la région, Olivier Jullien, et dans son sillon toute une génération de vignerons passionnés, ont démontré que l’on pouvait produire de grands vins en Languedoc, convaincus du potentiel de leurs terroirs. Désertant les plaines et reconquérant les coteaux, ils se sont rapidement imposés dans les dégustations.
Ici le style dépasse largement le cadre de l’encépagement, avec un retour en grâce de cépages locaux, qui rend le Languedoc passionnant par sa diversité.
Olivier Jullien délivre sous l’IGP Hérault, un blanc marqué par un cépage autochtone, le Carignan blanc, complété par le Chenin, cépage plus connu en bord de Loire. Olivier est le plus pur exemple du renouveau languedocien, une véritable « tête chercheuse ». Toujours à la recherche des terroirs les plus qualitatifs, son parcellaire (comprenez son vignoble) a été maintes fois modifié, toujours en quête du meilleur. Il en va de même avec le choix des assemblages. Il a pu utiliser jusqu’à plus de 10 cépages différents. Il a aussi testé différents contenants pour ses vinifications et ses élevages, de la cuve à des barriques plus ou moins grandes, plus ou moins jeunes. Son but à travers ce vin blanc est clair, délivrer une « eau de roche », pour exprimer au mieux le terroir.
On retrouve cette notion de terroir à la dégustation, avec un vin délivrant une grande salinité (signature minérale). Pour un vin méditerranéen, le vin est sans lourdeur et s’allonge en bouche avec une belle complexité aromatique.
L’aromatique est très différente dans le Mas de Daumas-Gassac blanc (IGP Hérault) qui illustre la grande originalité d’assemblages possibles en Languedoc. Ici le Chardonnay côtoie le Viognier, le Chenin et le Gros Manseng (plus connu à Jurançon). Le vin est envoûtant par son « envolée » aromatique, fruitée et florale. Sur 2020, il « roule » en bouche par son volume et sa chair mais n’oublie pas de rester frais.
Autre expression, autre grand vin blanc produit cette fois-ci sur le terroir basaltique de Pézenas, Aurel blanc, issu d’une pure Roussanne. A l’image de ce que peut délivrer ce cépage, le vin est d’une grande richesse, affiné par un élevage très long. Le travail le plus naturel possible dans la vigne et une approche de vinification quasi non-interventionniste jouent pour beaucoup aussi. Basile Saint-Germain est un vigneron exigeant. On le ressent dans la précision de cette Roussanne qui offre une pureté rarement égalée pour ce cépage.
Le Languedoc est avant tout une terre de « rouges ». La cuvée Terre de Jonquières 2019 en AOP Terrasses du Larzac est classiquement languedocienne dans son assemblage, mais la finesse et l’allonge fruitée évoquent l’équilibre d’un cru bourguignon. Les tannins sont d’une finesse incroyable, le vin digeste, élégant et complexe. Une belle reconversion à la fin des années 2000 pour le couple Goumard, ayant repris le vignoble du « paternel » d’Olivier Jullien, le Mas Cal Demoura.
Le Carignan noir, typiquement languedocien, est enfin redevenu un grand cépage, depuis qu’on le travaille à faibles rendements. Il offre une palette aromatique originale, sur le fusain, le zan, prenant des notes lardées avec le temps. Il est ici magnifié par Sylvain Fadat à Montpeyroux (ici en Vin de France). Le vin semble dense, avec un toucher de bouche soyeux. Grâce à la biodynamie, la fraîcheur est extraite du terroir pour équilibrer le vin, qui s’achève presque sur un côté « jus de fruit ».
Le Cinsault est lui plus habituel pour la production de vin rosé. Peu de vignerons s’aventurent à le travailler en rouge et en mono-cépage. Sa nature réductrice (comprenez un possible nez « giboyeux », mal venu à l’ouverture de la bouteille) requiert donc un grand talent.
La cuvée Capitelle au Clos des Centeilles à Minervois (Cécile et Patricia Domergue) dégustée sur le millésime 2001 offre une fraîcheur insolente au vu de son âge. Son équilibre est majestueux, la longueur infinie. On est ici au pays de « Shéhérazade », entre parfum de rose fanée et d’épices orientales. Le vin évoque un bel accord sur un tajine aux pruneaux. Pourtant « sur le papier » ce cépage de « demi-corps » ne devrait pas tenir la mesure face à l’agneau. La longue macération de raisins absolument parfaits à l’origine, doit expliquer cette tenue dans le temps. Quelle race !
J’aurais pu aligner une vingtaine de noms, tant les trésors à dénicher dans cette région sont légion. En tout cas, ces 6 vins ne sont représentatifs ni d’une appellation ni d’un type d’assemblage. Ils sont plutôt l’expression de grands terroirs, magnifiés par des vignerons talentueux et respectueux de leurs vignes et de leurs sols.